- Accès directs
L’art et la guerre d’AlgériePaul Bernard-Nouraud
Avec L’art et la race d’Anne Lafont, c’est la deuxième fois cette année que la collection « Œuvres en sociétés » des Presses du Réel dévoile un angle mort de la recherche française en histoire de l’art. Étrangement, Des damné(e)s de l’Histoire. Les arts visuels face à la guerre d’Algérie d’Émilie Goudal est la première étude à s’intéresser à cette mémoire du point de vue des arts plastiques, mettant en évidence un corpus d’œuvres jusque-là négligées, et à travers elles l’ombre posée sur les enjeux qu’elle soulèvent.
Émilie Goudal, Des damné(e)s de l’Histoire. Les arts visuels face à la guerre d’Algérie. Les Presses du Réel, coll. « Œuvres en sociétés », 352 p., 26 €
L’une des raisons qui ont poussé Émilie Goudal à « proposer un retour critique » sur ces sujets est précisément la méconnaissance que nous en avons. Deux auteurs d’un manuel scolaire d’histoire paru en 2010 ayant fait le choix inédit jusqu’à eux d’y reproduire un tableau de Jean Vimenet intitulé La guerre d’Algérie écrivaient ainsi dans la notice : « Vimenet semble être le seul peintre à avoir réalisé un tableau dont le sujet est explicitement la guerre d’Algérie. » « Preuve, commente l’autrice, que l’ampleur de la tâche est encore considérable pour inscrire cette production dans la mémoire collective mais aussi dans la généalogie des représentations artistiques de la guerre. »
Des damné(e)s de l’Histoire entend prendre part à cette inscription, qui intervient, principalement sous l’impulsion d’universitaires et de cadres épistémologiques formés à l’étranger, « au sortir d’une proscription historique de près d’une cinquantaine d’années après l’indépendance de l’Algérie ». Goudal partage certainement l’optimisme de Maureen Murphy, autrice en 2009 (toujours dans la même collection) d’une étude comparative sur les représentations des arts d’Afrique à Paris et à New York, qui voit dans « ce décalage temporel entre la France et les pays anglo-saxons » une chance permettant d’introduire « une once de questionnement critique salvateur et constructif ».
On dispose pourtant de peu d’indices permettant d’affirmer que l’histoire de l’art française se soit véritablement saisie d’une telle opportunité, sinon afin d’identifier les raisons de son retard en la matière. Lesquelles tiennent, pour l’essentiel, à une relative absence de curiosité pour ces questions de la part des historiens d’art et des conservateurs de musées, insuffisance qui a eu pour conséquence de les démunir peu à peu dans leur propre champ de compétences. Ce qui explique au passage que les plus récalcitrants d’entre eux face à ces nouveaux thèmes les jugent précisément étrangers à la discipline, et intentent un procès en légitimité à ceux qui chercheraient à les y promouvoir. Anne Lafont et Émilie Goudal héritent sur ce point d’une situation identique, et la première souscrirait sans doute au constat de la seconde : « Oubli ou impasse volontaire, reste que ces artistes peinent encore à percer un certain plafond de verre instauré par l’écriture de l’histoire de l’art en France. »
Cela dit, le cas algérien se complique d’une dimension politique particulière, où le défaut de reconnaissance mémorielle institutionnelle entrave la visibilité des œuvres qui évoquent ce « conflit non reconnu comme tel, et où l’objet culturel est souvent instrumentalisé ». « Guerre sans image » pour une mémoire sans vision qui entretient « la France dans son amnésie », écrit Émilie Goudal, et fige « l’Algérie dans l’artifice de l’hypermnésie ». L’autrice retrace ainsi longuement les difficultés à voir le jour et à constituer des collections permanentes propres (à partir de 2006) qu’a connues le Musée public national d’art moderne et contemporain (MAMA) d’Alger, sis dans un édifice néo-mauresque hérité de la période coloniale. Si des intérêts politiques expliquent en partie les obstacles rencontrés par l’architecte et les conservateurs du MAMA, c’est cependant sur des musées français qu’une censure plus ou moins insidieuse s’est abattue autour de la question de la représentation de la mémoire de la guerre d’Algérie. Goudal en livre deux exemples tout à fait révélateurs des stratégies de mise sous silence de ce passé.
Le premier porte sur une exposition de l’artiste algérienne vivant et travaillant depuis vingt ans à Londres, Zineb Sedira, à qui le musée du Jeu de Paume de Paris consacre actuellement une exposition : « L’espace d’un instant ». En 2010, au musée national Pablo-Picasso de Vallauris, la diffusion d’une vidéo d’un entretien qu’elle eut avec sa mère, Histoires re-racontées : ma mère m’a dit, provoque l’ire de deux associations d’anciens harkis, qui obtiennent le soutien du maire UMP d’alors, Alain Gumiel. Dans les sous-titres des propos tenus en arabe, le mot « harki » est traduit par « collaborateur », traduction que l’artiste modifie dans le sens des réclamations qui lui sont faites. Malgré cela, l’exposition est fermée par décision de l’édile pendant trois mois sur les six initialement prévus, et sa visite pourvue d’un avertissement rappelant que l’œuvre n’est pas « l’outil d’un débat de type politique », qui « peut s’instaurer dans d’autres enceintes que ce musée dont ce n’est ni la vocation ni l’intention à propos de cette exposition ». Le contenu du cartel fait plus que mettre à distance la portée politique de l’œuvre de Sedira « au profit de la libre expression artistique », comme l’écrit Émilie Goudal, il vide le musée de son rôle social et démontre par l’exemple pourquoi et comment de telles œuvres peuvent être soustraites à la vue du public.
Le second cas est peut-être plus éloquent quant aux ressorts profonds de ces mécanismes d’évitement. Il s’agit d’une toile monumentale de 5 × 4 m peinte en 1960 dans le sillage du Manifeste des 121 par six artistes : le Français Jean-Jacques Lebel, l’Islandais Erró et quatre Italiens, Enrico Baj, Roberto Crippa, Gianni Dova et Antonio Recalcati ; ce qui souligne en passant la proportion étonnante d’artistes étrangers au contexte de la guerre d’Algérie dans ses représentations. Exposé en 1961 à Milan, ce Grand tableau antifasciste collectif est saisi par la police pour offense à la religion d’État, et demeura pendant un quart de siècle dans les réserves de la questure de la ville, dont il est finalement extrait sur décision de justice en 1987. À cette censure sans détour succède alors une censure moins assumée lorsque les artistes font don de l’œuvre au musée Cantini de Marseille, après que le Centre Pompidou l’a refusée en 1988.
Prêté à deux reprises au cours des années 1990, le tableau demeure invisible à Marseille, et cela pour deux motifs : d’abord en raison de son format, incompatible avec les dimensions des cimaises du musée, problème de taille qui « en deviendrait presque poétique », relève Goudal, ensuite et peut-être surtout parce que « ce n’est pas Guernica », dixit la directrice des musées de la ville de l’époque, Danièle Giraudy. Aujourd’hui conservé au musée de Nantes, le tableau se perd ainsi « dans les affres des tensions mémorielles pendant plusieurs années », au cours desquelles on le propose même à la Cité de l’Immigration, manière d’asséner qu’en vertu du connoisseurship des professionnels de l’art une telle peinture ne relève pas véritablement de leur juridiction.
Retracer le fil des errances auxquelles fut soumis une telle œuvre répond au projet d’Émilie Goudal selon lequel l’histoire de l’art doit pouvoir, « au travers d’une analyse de la représentation artistique de cette guerre, contribuer au transfert d’une mémoire déchirée vers une histoire plus éclairée de cette période ». Cette volonté correspond à la conception que se fait notamment l’historien Gérard Noiriel, que l’autrice cite à plusieurs reprises, du rôle civique, plus que politique, de la science. Si l’intention est louable, et peut-être même salutaire dans les temps actuels, il n’est en revanche pas certain qu’elle serve parfaitement une histoire de l’art comme histoire des formes et non seulement des contextes socioculturels de production et de réception des œuvres.
Rappeler que le Grand tableau antifasciste collectif est une œuvre d’art qui s’inscrit dans la lignée des œuvres collaboratives du surréalisme ou de CoBrA décrit assez peu comment la dénonciation de la guerre d’Algérie y est mise en forme ou comment elle met ou non en tension les héritages des avant-gardes ; un tel angle permet moins encore d’apercevoir comment cette mémoire peut aussi échouer à se développer dans des œuvres qui ne font pas explicitement référence aux événements dont elles proviennent. Émilie Goudal endosse cependant ce parti pris dès l’introduction : « nous avons sciemment délimité cette anthologie aux œuvres strictement et directement identifiées comme se référant à la guerre d’indépendance ».
La délimitation claire du corpus entraîne une limitation de la portée de l’analyse comme de la diversité de ses objets, et le caractère prospectif de la recherche risque d’être rapidement cantonné à une thématique fondamentalement rétrospective, puisque définie dans sa relation avérée aux circonstances historiques. Émilie Goudal circonscrit d’elle-même ce risque en s’écartant quelquefois du cadre qu’elle s’était fixé, comme lorsque ses réflexions l’amènent à discuter la validité de la notion d’orientalisme sous laquelle la mémoire de la guerre d’Algérie pointe régulièrement. Car c’est à ce niveau que l’analyse peut faire autre chose qu’éclairer un débat, en prêtant attention à la façon dont un traumatisme mémoriel aussi déterminant agit au présent tout en demeurant caché – caché dans la pénombre d’une œuvre.
En savoir plus


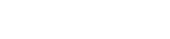




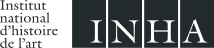 2 Rue Vivienne - 75002 Paris
2 Rue Vivienne - 75002 Paris
